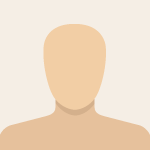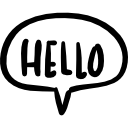Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Robert Redeker
- De New York à Gaillac : trajet d’une épidémie logotoxique
- Les Temps Modernes 2001/4-5 (n° 615-616)
- Commençons par la narration d’un incident qui en dit long sur le développement d’une judéophobie de gauche s’accompagnant de pratiques de censure[1].
- J’ai, dans le cadre du dernier Salon du livre de Gaillac, à l’invitation de la médiathèque municipale, prononcé une conférence sur le négationnisme titrée « L’Invisiblisation d’Auschwitz ». Le public était composé de gens de gauche, en particulier de militants d’Attac. A la fin de mon intervention, un des militants — déclarant par ailleurs appartenir au Cercle Marc Bloch dont l’épicentre siège à Lyon — s’est levé pour affirmer d’une part qu’il était « antisioniste », et d’autre part qu’il ne pouvait être question de laisser Israël, Etat raciste, justifier son existence et son « colonialisme » par l’usage de la mémoire de la Shoah. J’ai répondu que j’aimerais savoir ce que signifiait réellement « antisioniste », demandant si à la racine cette option politique ne constituait pas le déni du droit à l’existence pour Israël. « C’est bien, dis-je, le seul Etat du monde dont vous demandez la disparition, et vous trouveriez épouvantable et absolument raciste autant que potentiellement criminogène que quelqu’un se déclarât radicalement anti-allemand ou anti-espagnol, ou même anti-chilien. » J’ai doublé cette demande d’une autre sur le sens du mot « colonialiste » dans la mesure où, si on s’en tient à une déontologie lexicale indispensable entre intellectuels, Israël n’est stricto sensu ni un Etat colonial ni un Etat colonialiste. La salle (une centaine de personnes) est alors devenue tumultueuse, secouée d’un vent d’haineuse haleine ; brandir le nom d’Israël était agiter le chiffon rouge qui affole un certain public, notamment celui qui se pare des prestiges de l’antimondialisme. Certains se sont levés en hurlant : « C’est un scandale de faire l’éloge d’Israël à cette tribune » (car elle était consacrée à la question du négationnisme). D’autres ont dit, d’après ce qui m’a été rapporté : « On va lui casser la gueule. » D’autres encore, dont Jean-Marie Brohm et Monique-Lise Cohen, ont manifesté leur complète solidarité avec mes propos. J’ai répondu en précisant qu’il eût été, en effet, scandaleux de se livrer à la justification d’un régime criminel — par exemple l’Allemagne nazie — ou totalitaire, mais qu’Israël n’était ni un Etat criminel ni (à la différence des ex-idoles de tous les ex-fans du Kremlin reconvertis dans l’antimondialisation et l’antisionisme) un Etat totalitaire. Que n’ai-je pas dit avec cette affirmation pourtant frappée au coin du bon sens ? Un homme s’est même levé pour tonitruer que j’étais négationniste ; entendons par cet usage singulier de ce concept, appliqué en général aux négateurs d’Auschwitz, tels Rassinier et Faurisson : nier le colonialisme israélien et la « barbarie sioniste », c’est être négationniste. Une femme s’est dressée pour hurler, à gorge déployée : « Et Sabra et Chatila ? » L’énonciation de ces deux toponymes fonctionna soudain comme un équivalent symbolique d’Auschwitz renversant les Juifs du statut de victimes dans celui de coupables, et ce bien qu’à Sabra et Chatila ce sont des Arabes qui ont massacré d’autres Arabes. Je n’avais, je l’avoue, que rarement rencontré autant de haine, surtout à l’énoncé d’ arguments tout à fait raisonnables, dont l’aspect scandaleux n’existe qu’aux yeux de mes interlocuteurs de ce jour-là. Une pareille après-midi permet de se rendre compte que des pans entiers d’une certaine gauche antimondialiste réutilise les méthodes staliniennes de censure du débat, croyant dur comme fer à une vérité — la culpabilité absolue d’Israël — qu’elle refuse d’examiner raisonnablement. La gauche émotionnelle, celle qui s’est discréditée par une étrange complaisance à l’endroit des incidents, dont la coloration judéophobe et le contenu antirépublicain ne se cachaient pourtant aucunement, survenus à l’occasion du match de football France-Algérie, trahit, en de pareilles occasions, qu’elle est également une gauche obscurantiste qui ne veut rien entendre d’équilibré sur Israël et la Palestine[2], aux procédés d’intimidation totalitaires (il est vrai qu’aujourd’hui comme hier la foi victimologique figure souvent l’obstacle à tout débat argumenté) !
- Quelles leçons tirer de cet incident vécu, révélateur d’un nouveau climat intellectuel et politique ?
- De fait, depuis l’attentat du 11 Septembre dernier à New York, les occasions d’assister à la résurrection de la judéophobie de gauche (une vieille connaissance de l’histoire puisque, après être passée par le syndicalisme révolutionnaire et la Commune, on peut filer sa trace jusqu’à Proudhon et au-delà jusqu’aux Lumières[3]) se multiplient. Le fantasme, politiquement localisé à gauche, d’un complot mondial judéo-américain entre en symétrie avec celui (aujourd’hui éteint) du judéo-bolchévisme, qui était à la mode dans l’extrême droite du temps où l’URSS existait. Il s’avère de plus en plus fréquent d’entendre l’antimondialisme laisser remonter à sa surface le soupçon d’un judéo-américanisme planétaire. Dans tous les cas — balayant la totalité du spectre de la pensée politique, de l’extrême droite aux anarchistes[4] —, l’anti-américanisme et l’anti-israélisme s’amalgament, l’Amérique et Israël étant supposés projeter une domination capitaliste mondiale en faveur de leurs seuls intérêts.
- La seule prononciation du nom d’Israël fait perdre la raison à beaucoup de monde. Ce nom déclenche une réaction dévastatrice qui engloutit tout sur son passage ; de fait, la force ravageuse de cette hostilité anti-israëlienne demeure inexplicable sans le recours à l’hypothèse selon laquelle elle ne serait que l’écume d’une animosité beaucoup plus profonde, beaucoup moins circonstancielle qui trouve là, après avoir été condamnée à une durable clandestinité, un exutoire où éclater : la très vieille haine antijuive (qui a pris la tournure, au xixe siècle, de l’antisémitisme). Israël : ce statonyme est le nom interdit de prononciation sympathique sous peine de provoquer une tempête d’exécration. Israël : ce nom d’un Etat est devenu pour beaucoup, à gauche, le nouveau nom du Mal. Un nom qui — aujourd’hui que plus personne ne croit au Diable, chacun lui cherche des substituts tout aussi irrationnels. Israël est, dans une partie de la gauche française, un de ces commodes substituts laïcs à Satan, placé en opposition avec la figure angélisée du Palestinien et du jeune de banlieue — fonctionne à la façon d’un détonateur sémio-pulsionnel redoutablement efficace.
- Etrangement, l’immense majorité des discours entendus et lus à la suite des attentats du 11 Septembre retournent l’accusation contre les victimes. La désinhibition de la haine anti-israélienne a permis tout autant de changer les victimes, les Américains, en coupables que d’atténuer la responsabilité des coupables effectifs (le terrorisme islamique fomenté ou soutenu par un certain nombre d’Etats musulmans). Cette alchimie de pathopolitique fait glisser l’imputation de culpabilité du criminel vers la victime, autrement dit on nage en pleine économie sacrificielle. Le coupable est tenu pour innocent de son crime, la charge de la culpabilité est portée par la victime : ces deux éléments sont les caractéristiques principales de la logique du sacrifice. Du côté des assassins, comme du côté de cette partie de la gauche dans laquelle se réveille de son léger sommeil la vieille judéophobie, nous rencontrons une attitude inscriptible dans le registre religieux — le sacrifice constituant le cœur des religions. On doit même conclure à une régression pré-abrahamique du religieux, compte tenu qu’Abraham est la figure qui, dans l’histoire, clôt l’ère des sacrifices humains[5]; or, pour transporter la culpabilité de l’assassin vers la victime, les discours légitimateurs du terrorisme doivent couvrir la réintroduction du sacrifice humain. Pas de sacrifice sans discours qui le prépare, l’accomplit, puis le commente : tout un travail sémantique se déploie, dans les religions à sacrifices humains, pour changer un meurtre en acte symbolique à valeur sacrée. Ce discours, tenu par les castes sacerdotales, dit l’innocence du groupe sacrificateur. Toujours une savante prose enveloppe le sacrifice de sa logomachie, le déréalise, lui ôte sa matérielle épaisseur d’horreur, par exemple que les hôtesses de l’air aient été égorgées au couteau avant que les avions ne soient projetés contre les Twin Towers, toujours un discours s’impose pour assurer sa propre cohérence, pour donner à voir sa vérité dans l’occultation de l’horreur du meurtre. En cette occurrence, le discours justificatoire se divise en deux : le discours direct autodéculpabilisant des assassins et le discours indirect, qui inverse la charge de la culpabilité, de toute une partie de la gauche française quand, sous prétexte de renvoyer face à face en miroir létal les « Talibans du pétrole » et les « Talibans de Wall Street », elle affirme que les Américains l’ont bien cherché. Religiosité consciente — même si le geste sacrificiel, participant pourtant à l’essence du religieux, demeure non compris et non assumé comme tel — chez les assassins se réclamant de l’islamisme, et religiosité sauvage, totalement inconsciente, dans toute cette partie de la gauche se réclamant de l’antimondialisme, qui transfère la culpabilité sur les victimes.
- Cet ensemble d’événements permet de ressouder, à gauche, les couches intellectuelles et les couches militantes, reconstruisant une unité disloquée par l’histoire — à ceci près que, cette fois-ci, cette unité, au lieu de proférer comme naguère le discours de l’émancipation du genre humain à travers l’essence progressiste du prolétariat, tient celui de la régression rebarbarisante portée par l’islamophilie. Comment des esprits « de gauche », jadis progressistes, ex-thuriféraires du mythe moderne de l’émancipation universelle possibilisée par la classe ouvrière, peuvent-ils s’aveugler jusqu’à trouver quelque légitimation à l’islamisme, que ce soit celui des Palestiniens ou celui, violemment antirépublicain, des jeunes de banlieue qui se revendiquent, contre les institutions républicaines, à la fois de Ben Laden et de l’ultracapitalisme fétichisé dans les logos des marques Nike, Adidas, etc. ; prenant pour vertu ce que la tradition issue des Lumières, dans ce qu’elle possède de meilleur, nous a appris à combattre ? Tout se passe comme si l’anti-israélisme, amalgamé avec l’anti-américanisme et le propalestinisme, était le nouvel opium d’une certaine gauche : opium des intellectuels (pour reprendre une formule de Raymond Aron) et opium des militants, dans une articulation entre militants et intellectuels qui reproduit plus ou moins parodiquement une configuration qui avait cours dans les années 50 du siècle passé, lors des plus beaux jours du stalinisme. A la fin des années 70, on s’en souvient, survint une époque de décrochage entre le monde militant et le monde intellectuel. C’est cette déconnection qui aujourd’hui s’est partiellement effacée. Certains milieux intellectuels et certains milieux militants fusionnent à nouveau, sous le signe d’un nouvel opium totalitaire dont les guises les plus fréquentes sont l’antisionisme, l’islamophilie et le propalestinisme[6].
- L’épidémie la plus virulente, ajointée à ces attentats, n’est peut-être pas celle due à la guerre bactériologique, mais l’épidémie idéologique qui, si elle poursuivait son développement, consacrerait le triomphe des terroristes : répandre planétairement les spores du virus judéophobe, ou bien en réveiller les souches dormantes. De New York à la petite bourgade tarnaise de Gaillac, cette sinistre panspermie a déjà disséminé son poison logotoxique, paralysant partout où elle le peut l’usage de la raison critique.
- 11 octobre 2001
- Notes
- [1] La théorisation de cette judéophobie a été proposée par Pierre-André Taguieff, dans un article titré « Les nouveaux visages de l’antisémitisme », Le Figaro, 8 octobre 2001.
- [2] Comme le sont les pertinents arguments de Christian Delacampagne, dans son article « Lettre à un ami Palestinien », Commentaire, automne 2001.
- [3] Lire à se sujet Simon Epstein, Les Dreyfusards sous l’Occupation, Paris, Albin Michel, 2001. Et aussi Marc Crapez, La Gauche réactionnaire, Paris, Berg International, 1999.
- [4] Sur l’amalgame, à l’issue de la guerre des Six Jours, de l’anti-américanisme et de la judéophobie, à l’extrême droite, lire Nicolas Lebourg, « L’invention d’une doxa néo-fasciste », Domitia, octobre 2001.
- [5] Rien de plus fondateur que le non-sacrifice d’Isaac par Abraham ! Arriva enfin un jour, sans doute après des siècles de critique du sacrifice, où s’imposa une « coupure spirituelle » dans l’histoire de l’humanité, symbolisée par un acte inouï de désobéissance : Abraham, refusant de sacrifier son fils, désobéit à l’ordre social fondant par là même le messianisme, ce salut par les fils qui met fin aux sacrifices d’enfants (alors que dans la tragédie d’Euripide, Iphigénie à Aulis, le sacrifice de l’enfant à la place du père est encore présent) et ouvre l’avenir. Refoulé, le sacrifice fait retour dans d’épouvantables régressions, marquant une certaine permanence : une analyse précise des crimes commis par l’ETA, de l’étonnante affaire de l’abbé Cotard, ou des discours autour des attentats du 11 Septembre, montrerait leur lien à la logique sacrificielle. A ce sujet, lire Bernard Lempert, Critique de la pensée sacrificielle, Paris, Le Seuil, 2000.
- [6] D’ailleurs, le concept d’islamisme (intégrisme) se révèle trop réducteur pour appréhender un phénomène planétaire dont les répercussions agissent jusque dans les banlieues des grandes villes françaises, circonscrivant le phénomène totalitaire dans une définition aussi minimale que rassurante ; il convient de lui substituer celui d’islamisation de la vie collective, plus précis, qui cerne mieux une réalité dynamique conjointement macropolitique (niveau géopolitique planétaire) et micropolitique (les banlieues).
Add Comment
Please, Sign In to add comment