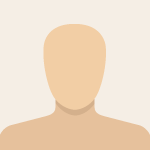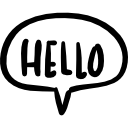Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Smaïn Laacher, L'antisémitisme, une histoire de famille?
- Le Monde, samedi 23 janvier 2016
- Immigrés juifs et musulmans du Maghreb ont longtemps été proches malgré un préjugé judéophobe bien ancré. Et qui parfois, transmis à certains jeunes, s'est exacerbé.
- La question des liens réels ou supposés entre antisémitisme et populations immigrées de confession musulmane en France est un thème difficile à examiner sans suspicion de part et d'autre. Il importe, tout d'abord, de mentionner une limite objective, qui souvent provoque indignations ou invectives : celle d'une rareté d'études examinant la nature des liens possibles et leurs expressions. Populations juives et musulmanes, surtout celles issues d'Afrique du Nord, se connaissent en réalité depuis longtemps. La colonisation française avait fait vivre séparément ou ensemble une pluralité de nationalités et de confessions, majoritairement issues des trois religions monothéistes. Surtout, juifs et musulmans du Maghreb parlaient la même langue et se parlaient dans la même langue.
- Lors de la décolonisation, les immigrés musulmans en terre d'immigration étaient le plus souvent proches des juifs ayant vécu au Maghreb. Il n'est nullement exagéré de dire qu'il y a eu, hier, une vie commune qui demeure encore aujourd'hui malgré les conflits et les tensions. Certes, il existait un antisémitisme mais son expression était moins structurante que dans les jeunes générations actuelles. La question se pose donc de savoir si, comme on le prétend parfois, depuis la fin des années 1980, les relations entre ces deux groupes de populations se sont modifiées à tel point que l'antisémitisme s'est imposé comme une pensée politique dans l'immigration maghrébine. La réponse est non pour la première génération d'immigrés maghrébins et oui pour une minorité de jeunes.
- Je résume ces changements à grands traits : d'abord, une accentuation des inégalités sociales et culturelles avec leur lot de marginalisation et de haine sociale. Ensuite, le renforcement du processus d'un entre-soi forcé, à la fois dans la famille et la ghettoïsation de l'espace public, produisant un ordre interne articulé autour du sexe, de l'ethnie et de la religion. Enfin - et on a tort de sous-estimer cette dimension géopolitique -, le « monde arabe » et ses turpitudes se sont invités dans les conversations et les disputes des familles issues d'Afrique du Nord.
- Dans cette nouvelle configuration, l'enjeu premier pour les immigrés de confession musulmane n'est nullement l'antisémitisme mais bien comment faire avec un islam moins confidentiel et plus politique - plus « savant », plus « protestataire » et non plus seulement oral - et comment être un musulman « conforme . Dans le cas des immigrés et de leurs enfants, la religion est le dernier support auquel il est possible de s'accrocher. Mais c'est une religion sans nation, sans terre ni cadre temporel et spirituel approprié. Elle semble surtout avoir pour fonction d'affirmer bruyamment, mais de manière artificielle, une série d'appartenances politiques à des sociétés dominées ou jugées comme telles : les Arabes, les musulmans, les pays encore colonisés, etc.
- le « eux » contre le « nous »
- Cette sorte de solidarité instinctive pour les identités aliénées trouve ses formes d'expression dans la médiation de la religion et dans le soutien à la « lutte du peuple palestinien » hier, et de la Syrie aujourd'hui. Ce qui sépare la période des parents de celle de leurs enfants, c'est que les premiers (parents) verront et les seconds (enfants) subiront le délitement du collectif et la disparition du tissu associatif qui contribuait à créer du lien social et solidaire. Au chômage de masse, à l'ethnicisation des rapports sociaux et au démantèlement de l'Etat-providence, les groupes sociaux les plus socialement fragiles ont répondu, pour certains, par une demande de national-populisme, pour d'autres par un communautarisme artificiel.
- C'est seulement pour ceux dont la figure idéale est l'auteur du tweet « Nous sommes Kouachi » que l'antisémitisme est devenu synonyme de haine politique du juif. C'est lorsqu'un jeune à Marseille, « au nom d'Allah » - et ce au nom de quoi est accompli cet acte doit être pris très au sérieux - et de l'organisation Etat islamique, agresse à la machette un enseignant juif parce qu'il est juif et dans un désir sans équivoque de mise à mort, que l'antisémitisme devient un acte politique assumé. Ici, nous sommes loin du « simple » préjugé judéophobe.
- Entre ce dernier sentiment, plus domestique que public, et l'antisémitisme qui prévaut dans la société française, bien au-delà de la communauté maghrébine, la différence est radicale. Entre un jugement provisoire, que la persuasion peut ébranler, et une idéologie antisémite explicitement tournée vers la haine de l'autre, il n'y a rien de commun. En aucun cas le préjugé ne se présente et ne se dépose dans le cerveau des enfants en tant que conditionnement éducatif ayant pour finalité de produire de petits antisémites susceptibles de passer un jour au meurtre. La désaffiliation, cette absence d'identification positive à son « monde vécu », est aussi un monde vécu tragiquement divisé. C'est le « eux » (les groupes occupants des positions dominantes dans la société que l'on prête à la « communauté » juive) contre le « nous » : faible, sans place enviée, atomisé et sans solidarité (que l'on prête à la « communauté » maghrébine). L'antisémitisme de ces jeunes issus de l'immigration maghrébine pour qui le juif incarne négativement le complot permanent et le « deux poids, deux mesures » va bien plus loin que le préjugé judéophobe de leurs parents. On ne peut pas faire semblant de penser que la structure familiale est d'un effet nul sur la construction des représentations subjectives. Ce serait absurde.
- Aussi, ce n'est pas à l'école qu'il faut débusquer l'antisémitisme. Les modes de socialisation sont déterminants. C'est précocement que la langue de la maison, de l'entre-soi, s'apprend sur le mode du « cela va de soi . Elle est enracinée bien avant toute scolarisation. Elle est déjà là. Et sur cette langue de l'intérieur et donc de l'intériorité sont déposés les mots qui désignent les gens haïssables et les gens « bien » que l'on donne en exemple, ceux que l'on doit fréquenter et ceux que l'on doit impérativement éloigner de soi et des siens. Les sciences sociales nous ont appris que tous les groupes, quelles que soient leur nationalité, leur confession ou leur position sociale, ont à leur disposition un stock de mots, d'expressions et de « figures repoussoirs », mobilisables selon les circonstances pour désigner avec douceur ou brutalité ceux qui seraient des êtres inférieurs et ce qu'il en coûte de s'écarter des normes culturelles dominantes.
- Que l'on vive dans un monde sans y appartenir (pour les parents), ou dans une société sans avoir le sentiment qu'elle est une demeure naturelle (pour les enfants), le résultat est à peu près le même : c'est être condamné à ne pas compter et à ne pas être compté dans la communauté nationale. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Il n'y a pas là seulement une désespérance de déclassé ou de désaffilié. Celui ou celle qui prend le visage du Mal(le mot doit être dit), quelqu'un de presque banal, pense que son salut ne pourra résulter que de l'élimination des « impurs . Dans cette aventure mortifère, le juif n'est pas seul visé. L'accompagnent tous les blasphémateurs, mécréants et profanateurs de toutes sortes. A-t-on oublié que la haine était un idéal universel?
- Smaïn Laacher est professeur de sociologie à l'université de Strasbourg (Dynamiques européennes). Il a dirigé le Dictionnaire de l'immigration en France (Larousse, 2012)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement