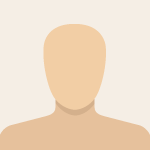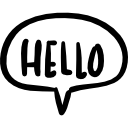Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Israël et la recherche française
- Armand Laferrère (Commentaire 2021/4 no 176)
- Thomas Vescovi : L’Échec d’une utopie. Une histoire des gauches en Israël. (La Découverte, 2020, 368 pages.). Samy Cohen : Israël. Une démocratie fragile. (Fayard, 2021, 286 pages.)
- De même qu’il existe une tonalité particulière, immédiatement reconnaissable, aux recherches russes en géopolitique ou aux études américaines sur les structures d’oppression, on trouve, dans les publications françaises sur Israël, quelques leitmotivs immanquables qui témoignent d’entrée de jeu de la nationalité des auteurs. Deux récents ouvrages sur Israël, de la part d’auteurs de sensibilité politique différente, mais baignant dans le même univers intellectuel français, le montrent une fois de plus.
- Le plus récent de ces ouvrages – celui de Samy Cohen, directeur de recherche à Sciences Po – est le plus modéré dans sa critique de la société israélienne. Il est aussi le mieux informé ; il évite en particulier certains canards relatifs à l’histoire d’Israël, que la plupart des historiens ont contestés depuis des décennies ou dont ils ont montré la complexité (tel le « plan Daleth », dont nous reparlerons plus tard). Lorsque l’auteur critique ouvertement des épisodes militaires de l’histoire d’Israël, c’est malheureusement, comme pour les exécutions injustifiables de civils à Kfar Kasem le 29 octobre 1956, de manière absolument justifiée.
- Et pourtant, malgré cette prudence méthodologique et cette bonne maîtrise des sources, l’ouvrage finit par n’être qu’une longue partition supplémentaire sur les thèmes obligatoires des commentaires venus de France. Le poids croissant des mouvements religieux en Israël est une menace pour la démocratie ; le durcissement de l’opinion israélienne face à la question palestinienne menace la place d’Israël au Proche-Orient ; les opérations militaires d’Israël sont disproportionnées à la menace réelle ; Israël prouve son mépris pour le bon fonctionnement de la communauté internationale en n’appliquant pas les résolutions de l’ONU qui lui enjoignent de rendre des territoires. Tout un chapitre est par ailleurs consacré à expliquer que l’évolution vers la droite de la société israélienne est une menace pour la survie de sa démocratie.
- Il y a trois niveaux de réponse à ces affirmations, que dans un cadre français il faut bien appeler des lieux communs.
- Le premier est de signaler une certaine confusion primordiale, qui court du début à la fin du livre, entre fonctionnement démocratique et valeurs de gauche. L’unique raison de l’évolution droitière de la société israélienne est, après tout, le fonctionnement démocratique du pays.
- Des questions dont, dans d’autres sociétés, les électeurs seraient tenus à l’écart sont, en Israël, soumises à leur avis. C’est notamment le cas de la question du retour des Juifs dans la partie de la terre de leurs ancêtres qu’Israël a reprise en 1967 à la Jordanie et à la Syrie. De nombreux gouvernements de gauche, de 1967 à 1977 et de 1998 à 2001, auraient préféré éviter la multiplication de ces implantations. Ils les ont tolérées parce que, n’étant pas des chercheurs français, ils considéraient que la démocratie impose de respecter la volonté du peuple. De même, lorsque Cohen regrette ce qu’il considère comme la timidité des juridictions israéliennes face à l’installation de Juifs en Judée-Samarie, c’est lui qui utilise un argument ouvertement antidémocratique pour regretter que les opinions d’une minorité n’aient pas été imposées à la majorité par des juges non élus.
- La deuxième faille de l’approche française, que l’on retrouve dans le livre de Cohen, est qu’elle ne prend pas suffisamment au sérieux le troisième terme (trop souvent implicite) du projet israélien. Il ne s’agit pas seulement de faire vivre un État juif et démocratique ; il faut aussi que cet État soit établi pour toujours. Il est donc parfaitement normal de traiter avec une certaine distance les acteurs qui visent sa destruction à moyen ou long terme. Toutes les organisations palestiniennes font explicitement de cette destruction leur objectif stratégique : il n’y a donc pas de raison particulière de leur faire des concessions territoriales ou sécuritaires qui ne feraient que les aider à faire progresser cet objectif. Les résolutions de l’ONU que l’on reproche à Israël d’ignorer (et qui, l’auteur oublie de le rappeler, n’ont pas de force obligatoire) doivent une partie de leur rédaction et de leurs voix à des États qui soit souhaitent ouvertement, soit considèrent comme inéluctable la fermeture future de la parenthèse israélienne. Un peuple attaché à survivre n’a pas à accorder plus d’importance que nécessaire aux intérêts de ceux qui veulent le tuer.
- Cohen passe sous silence cette hostilité existentielle, qui explique pourtant une grande partie des politiques qu’il critique. Il ne fait pas non plus le lien entre la droitisation de la société israélienne qu’il dénonce et l’échec des accords d’Oslo de 1993, lorsqu’une autorité palestinienne enfin reconnue n’a utilisé son implantation que pour lancer une nouvelle guerre, dite « seconde Intifada », dont l’objectif stratégique était de décourager les Israéliens et d’engager le démantèlement à terme du pays. Toute une génération a grandi en craignant d’être assassinée, à la terrasse d’un café ou dans un bus, par ceux-là mêmes à qui leur gouvernement avait accordé une reconnaissance et une autorité sur une partie du territoire. C’est le genre d’expérience qui en droitiserait plus d’un.
- Quant à l’impact qu’ont les politiques israéliennes sur l’acceptation d’Israël dans la région, l’analyse de Cohen ne rend pas compte de l’impressionnant rapprochement diplomatique avec les États arabes qui a trouvé son apogée dans les accords d’Abraham de 2020. Or, ce rapprochement s’explique parfaitement si l’on prend en compte la détermination israélienne à survivre.
- Le principal obstacle à un rapprochement entre Juifs et Arabes au Moyen-Orient n’a jamais été, comme l’intégralité des commentateurs français semble le penser, l’insatisfaction des Palestiniens. Le principal obstacle était la croyance, répandue dans le monde arabe, qu’Israël était un phénomène temporaire. Il n’y a aucune raison de se rapprocher d’un voisin qui aura disparu dans quelques décennies. Si Israël avait accepté les résolutions de l’ONU et la pression internationale et rendu davantage de territoires, immédiatement transformés en bases militaires pour des attaques futures, l’hostilité arabe n’aurait donc fait qu’augmenter. Au contraire, en résistant aux demandes faites par les Palestiniens ou pour eux, l’État d’Israël a montré à ses voisins qu’il est décidé à ne jamais disparaître et qu’il peut être profitable de chercher des intérêts communs. Une fois établie la pérennité de l’État juif, ces intérêts communs ont été faciles à trouver, aussi bien du point de vue stratégique que de celui du développement économique.
- Enfin, un troisième niveau de réponse aux thèses françaises vient de leur incompréhension totale de la nature des évolutions de la société israélienne. Le terme de droitisation, employé à l’envi par Cohen comme par d’autres, fait échapper à l’analyse une autre évolution de la société israélienne : les progrès considérables de la tolérance réciproque entre les différents groupes qui la composent.
- Il ne suffit pas, il est vrai, qu’un gouvernement respecte la volonté de la majorité pour que la démocratie soit préservée. C’est même le contraire qui se produirait si les minorités se trouvaient privées de leur liberté. Mais c’est précisément le contraire qui s’est produit dans la démocratie israélienne depuis la grande rupture de 1977, lorsque les partis de gauche ont perdu pour la première fois le pouvoir.
- Plutôt qu’une évolution homogène de la société vers la droite, on a vu la fin d’un mode de vie « israélien » homogène et son remplacement par une coexistence entre plusieurs modes de vie : les « quatre tribus » – laïcs, nationaux-religieux, ultra-orthodoxes et Arabes – dont parlait l’ancien Président Reuben Rivlin dans un discours resté célèbre.
- Dans les premières décennies de l’existence d’Israël, les hommes ashkénazes laïcs et progressistes imposaient leurs valeurs à tous, moyennant des accommodements négociés de manière centralisée et qui s’imposaient, là aussi, à tout le pays. Aujourd’hui, de larges communautés ultra-orthodoxes et national-religieuses sont en effet apparues. Mais, dans le même temps, l’Israël laïque l’est devenu avec moins de complexes. Il est bien plus facile aujourd’hui qu’il y a trente ans de trouver des restaurants ou des lieux de distraction ouverts le shabbat. L’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans l’Israël laïque est l’une des plus avancées au monde. Les homosexuels ont obtenu un degré d’acceptation bien supérieur à ce qu’il était dans l’Israël de gauche dont Cohen, comme toute l’université française, semble nostalgique.
- Le système électoral israélien lui-même, si critiqué et si critiquable, a concouru à cette progression de la tolérance. La représentation proportionnelle intégrale oblige, pour former des gouvernements, à faire travailler ensemble des groupes qui préféreraient ne pas s’adresser la parole. La coalition Netanyahu comprenait à la fois des généraux, des rabbins antisionistes et des homosexuels progressistes ; celle de Bennett comprend des nationaux-religieux vivant en Judée-Samarie, des membres de l’extrême gauche fanatiques de la rétrocession de terres, des islamistes. Ces coalitions incarnent parfaitement le nouvel Israël, dans lequel toutes les communautés ont acquis une plus grande liberté, mais préservent la capacité de coexister et de coopérer.
- Sous ces réserves importantes, le livre de Samy Cohen reste riche, bien informé et sans excès dans ses critiques. On peut simplement regretter quelques inexactitudes qui seraient faciles à faire disparaître dans une deuxième édition. L’auteur sait nécessairement, par exemple, que l’aspiration à la moralité au combat dans l’armée israélienne n’est pas qu’un dogme ou une formule, comme il le dit p. 193, mais repose très concrètement sur le rôle unique donné aux juristes dans l’accompagnement des opérations et la décision d’ouvrir le feu. De manière plus amusante, il ne peut pas ignorer que la caste religieuse des cohanim ne coïncide pas avec le groupe des « personnes portant le nom de famille Cohen ».
- On ne peut malheureusement pas constater la même modération dans le deuxième ouvrage, celui du chercheur Thomas Vescovi, précédemment auteur d’un ouvrage sur la mémoire de la Nakba en Israël. Vescovi a fait préfacer son ouvrage par une figure historique de l’extrême gauche antisioniste, Michel Warschawski, ancien responsable de la Ligue communiste révolutionnaire et candidat aux élections israéliennes sur diverses listes nationalistes arabes. Vescovi a, lui aussi, beaucoup lu ; mais, fidèle à ses influences marxistes, il n’a aucune réticence à aligner les arguments de la plus mauvaise foi, souvent désavoués depuis longtemps par les historiens eux-mêmes qui, comme Benny Morris, les avaient mis en avant quelques années auparavant.
- Pourtant, l’idée maîtresse du livre – celle selon laquelle la gauche sioniste, qui a présidé à la création de l’État et l’a dominé politiquement pendant trente ans, a désormais échoué – est profondément juste. Elle aurait mérité une analyse approfondie des raisons de cet échec pourtant paradoxal, de la part de l’un des mouvements politiques dont l’héritage – rien de moins qu’un nouvel État et la réalisation d’un espoir de deux mille ans – est l’un des plus impressionnants de l’histoire.
- Au lieu de cela, Vescovi tente de démontrer que l’échec de la gauche sioniste vient de son trop grand attachement… au sionisme. Le fait qu’elle a été remplacée, comme force politique centrale de l’État d’Israël, par la droite sioniste héritière de Jabotinsky aurait pourtant pu le faire réfléchir : si c’était le sionisme qui avait perdu la gauche, il ne serait pas le caractère le plus important de ses successeurs.
- Vescovi, cependant, est trop occupé à promouvoir l’alternative d’une gauche non sioniste, remplaçant l’objectif d’une démocratie juive éternelle par celui d’un État de tous ses citoyens sans distinction de culture et de religion, pour voir la contradiction. Il consacre de longues pages à décrire dans le détail les évolutions et les débats internes de cette gauche non sioniste, un groupuscule sans base électorale dont l’axiome unique – la possibilité de créer un partenariat judéo-arabe de long terme par des concessions unilatérales sans fin de la part des Juifs – peut aisément être réfuté par n’importe quel Israélien de 10 ans.
- Pour faire la promotion de cette thèse extrême, Vescovi utilise, comme tous les extrémistes, des déformations massives et réfutées depuis longtemps de l’histoire d’Israël.
- Non, la conduite des combats dans la guerre d’indépendance ne s’est pas faite en application du « plan Daleth », un plan théorique d’expulsion systématique des Arabes qui avait été préparé à titre d’hypothèse de travail, mais qui resta dans les cartons. Il y eut des expulsions dans certains endroits, mais pas dans d’autres, en fonction de l’appréciation de la situation locale par les différents commandants. Une partie des Arabes qui quittèrent Israël, surtout dans les premiers jours de la guerre, le firent à l’appel des dirigeants arabes qui leur promettaient un retour triomphal.
- Non, la raison de l’échec d’Oslo n’est pas que les Palestiniens s’y sont vu offrir une autorité qui n’était pas encore un État, mais qu’ils ont immédiatement utilisé les nouveaux moyens mis à leur disposition pour commencer les attaques sur Israël et préparer une guerre généralisée sous le nom de « seconde Intifada ».
- Non, la raison de l’échec des négociations lancées en 2000 par le Premier ministre Barak n’est pas qu’il n’avait pas donné assez : les Palestiniens auraient pu avoir un État sur une surface égale à 100 % des territoires jordaniens conquis en 1967, hors Jérusalem-Est et moyennant des échanges de territoires et le maintien, pour des raisons de sécurité, de 10 % des troupes israéliennes à certains endroits stratégiques. Quand on est en position de faiblesse et qu’on refuse de toper là à 100 %, c’est que l’on ne veut rien accepter d’autre que l’extermination complète de son adversaire.
- Les Warschawski et Vescovi de ce monde répètent de manière incantatoire un récit dans lequel les Palestiniens sont sans reproche et où tout échec aurait pu être évité, pourvu seulement qu’on leur offre davantage. Ce récit, porté à son aboutissement, aboutirait à la disparition d’Israël, entraîné dans une chaîne toujours croissante de concessions jusqu’à concéder son existence même. Cela est si évident pour les Israéliens que les mêmes auteurs qui pérorent sur l’échec de la gauche sioniste ont les plus grandes difficultés à faire survivre, dans des salles enfumées, leur secte sans électeurs, sans base politique et sans avenir. On ne peut pas empêcher ces extrémistes en transe de publier, mais on ne peut que tirer bénéfice à s’épargner leur lecture.
Add Comment
Please, Sign In to add comment