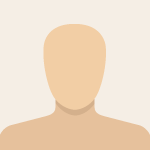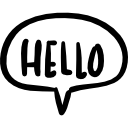Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Le Coran : comment a-t-il été écrit ?
- L'Histoire, no. 472, juin 2020
- Entretien avec Mohammad Ali Amir-Moezzi
- (Propos recueillis par Julien Loiseau, Ariane Mathieu et François Mathou)
- L'Histoire : Qu'est-ce que le Coran ?
- Mohammad Ali Amir-Moezzi : Pour les fidèles musulmans, le Coran est la parole de Dieu, révélée à Muhammad1 par l'intermédiaire de l'archange Gabriel (Djibril en arabe), au début du VIIe siècle de notre ère. Il s'agit du texte le plus saint de l'islam, avec le hadith (« enseignement », « propos »), c'est-à-dire l'ensemble des paroles de Muhammad, transmises par la tradition islamique à travers une série de recueils postérieurs. Le hadith fait lui-même partie de ce que les musulmans appellent la sunna (« voie », « cheminement »), qui recouvre tout ce que la tradition nous a légué concernant le Prophète, non seulement ses paroles, mais aussi ses actions, ses jugements, ses comportements, ses silences.
- Pour l'historien, la définition est, comme vous vous en doutez, un peu plus complexe. En réalité, le Coran est un texte composé et composite, à la fois littéraire, religieux et historique, qui réunit des textes de genres et de styles très différents (conseils religieux, préceptes juridiques, écrits oraculaires, prières, etc.), datés dans leur grande majorité du VIe-VIIe siècle. Le corpus a probablement plusieurs auteurs, qui ont consigné les propos du Prophète, mais qui en ont aussi retranché et ajouté d'autres. Les sources musulmanes en parlent elles-mêmes. La distinction avec le hadith ne va pas de soi et il y a sûrement eu une phase d'indistinction entre ce qui était considéré comme relevant de la parole de Dieu, transmise par le Prophète, et ce qui relevait de la parole du Prophète lui-même.
- A l'exception notable d'inscriptions plus anciennes retrouvées en Arabie, il s'agit aussi du plus ancien témoignage littéraire connu de langue arabe, la poésie arabe dite antéislamique ayant été recueillie et fixée par écrit plus tardivement.
- L'Histoire : Comment le Coran est-il structuré ?
- Le Coran tel que nous le connaissons aujourd'hui est divisé en 114 sourates (chapitres), classées en gros de la plus longue à la plus brève : les premières sourates s'étendent sur plusieurs dizaines de pages tandis que les dernières font seulement quelques versets. A ce premier mode de classement la tradition en ajoute un second, en divisant le Coran selon les deux grandes époques de la vie du Prophète, qui aurait vécu successivement à La Mecque (v. 570-622) et à Médine (622-632). En théorie, il existe donc des sourates mecquoises et des sourates médinoises. Mais, dans les faits, on trouve des versets mecquois à l'intérieur des sourates médinoises, et inversement. L'ordre chronologique initial a donc été complètement bouleversé.
- L'Histoire : Quelles sont les grandes thématiques abordées dans le texte ?
- Pour résumer à l'extrême, elles constituent ce que les historiens appellent le « credo coranique », qui repose sur trois grands principes : l'unicité divine, c'est-à-dire le fait que Dieu est unique, un principe très fréquemment affirmé dans le Coran1 le prophétisme, c'est-à-dire le fait que Dieu décide de temps en temps d'envoyer sa parole à des prophètes qui la transmettent ensuite à leur communauté1 enfin, le Jugement dernier, moment où les hommes seront récompensés ou châtiés pour leurs actes, ce qui inclut à la fois l'apocalyptique (ce qui intervient juste avant la fin du monde) et l'eschatologie (ce qui advient à ce moment et après le Jugement, ici et dans l'au-delà). On trouve également dans le Coran des conseils moraux, des préceptes juridiques, et d'autres choses, mais les thèmes principaux sont ceux que je viens d'évoquer et qui sont tous des thèmes bibliques.
- L'Histoire : Justement, quelle est l'influence des monothéismes juif et chrétien sur le Coran ?
- Elle est immense. Ce qui est frappant, c'est le décalage entre le texte coranique lui-même, qui se présente clairement comme un prolongement de la Torah et de l'Évangile et ne cesse de décrire le Prophète comme le continuateur d'Abraham, de Moïse et de Jésus, et le discours tenu par l'apologétique musulmane après la naissance de l'Empire arabe, qui tâche de présenter l'islam comme une religion totalement indépendante.
- Dans les faits, contrairement à ce que dit l'apologétique musulmane, l'Arabie préislamique était profondément imprégnée de culture biblique et n'était absolument pas une terre païenne peuplée de Barbares idolâtres, ce que montrent des découvertes réalisées, entre autres chercheurs, par Frédéric Imbert et Christian Julien Robin (cf. p. 46). La preuve la plus absolue réside d'ailleurs dans le Coran lui-même : à côté des quelques versets mentionnant les idoles ou les prophètes de l'Arabie préislamique, il y a des milliers de citations sur des thèmes et des personnages bibliques, depuis Adam et Ève jusqu'à Marie et Jésus, en passant par Noé, Abraham et Moïse. Cette influence biblique est visible dans les thèmes du Coran, comme je l'ai dit, mais également dans son vocabulaire, qui doit beaucoup au syriaque et à l'hébreu, les langues liturgiques du christianisme et du judaïsme. Ainsi, le mot arabe quran, « récitation », qui sert à désigner le Livre saint de l'islam, vient du syriaque qoryana, qui signifie « livre de prières ». Les mots sura (« chapitre »), aya(« verset »), salat (« prière quotidienne ») et zakat (« aumône ») proviennent également du syriaque, tandis que hajj,qui désigne le grand pèlerinage à La Mecque, et umra, le petit pèlerinage, viennent de l'hébreu.
- Si l'influence des monothéismes antérieurs sur la rédaction du Coran est incontestable, il est en revanche plus difficile de savoir quelles traditions ont le plus pesé et à quel courant se rattachait Muhammad : était-il juif ? chrétien ? Si oui, appartenait-il à un courant chrétien non trinitaire, c'est-à-dire refusant le dogme de la Trinité et donc celui de l'Incarnation, comme il en existait à l'époque, ou plutôt à une communauté de Juifs qui avaient conservé leurs croyances et leurs pratiques (circoncision, sabbat), mais qui acceptaient Jésus comme étant le Messie ? Il y a de passionnants débats sur ces questions.
- Jusqu'aux années 2000 on pensait que l'influence la plus forte avait été celle du judaïsme, en particulier des littératures parabibliques talmudique et midrashique. Depuis, on tend plutôt à insister sur le poids des christianismes orientaux de langue syriaque et surtout ceux jugés hérétiques par la grande Église catholique de Constantinople (arianistes, montanistes, etc.), car ils n'acceptaient pas la nature pleinement divine de Jésus : pour eux, Jésus était le Verbe et l'Esprit de Dieu, mais pas Dieu lui-même. D'où l'insistance du Coran sur la filiation de Jésus, systématiquement présenté comme « fils de Marie », pour ne pas dire « fils de Dieu », ce qui en soi constitue une prise de position des rédacteurs du Coran dans les controverses christologiques qui remuent l'Empire byzantin depuis plusieurs siècles.
- En même temps, il est vrai que le judaïsme est parfois très présent dans ces christianismes orientaux. L'hypothèse la plus courante actuellement est donc que la forte empreinte du judaïsme sur le Coran est l'oeuvre d'un judaïsme passé par le filtre des christianismes orientaux.
- L'Histoire : De quand date le Coran ? Est-il entièrement contemporain de Muhammad ?
- Il est difficile de répondre à cette question de manière simple car, comme je l'ai dit, le Coran n'est pas un texte unique, mais un ensemble composite de textes probablement compilés et/ou rédigés par des auteurs différents, à des périodes différentes. Encore aujourd'hui, de nombreuses zones d'ombre demeurent sur la vie de Muhammad et la genèse du Coran (cf. p. 36).
- En revanche, ce qu'on ne met plus en doute, c'est l'existence d'un Muhammad historique. De plus en plus d'historiens pensent qu'au moins une partie du Coran est l'oeuvre de Muhammad lui-même, ou du moins le produit de ses expériences spirituelles. C'est notamment le cas des 30 ou 35 dernières sourates, qui constituent ce qu'on appelle l'apocalyptique coranique, c'est-à-dire la description de la fin imminente du monde. L'attribution de ces sourates à Muhammad se justifie à la fois par leur ancienneté (il s'agit des strates les plus anciennes du corpus coranique, rédigées dans un arabe archaïque d'une extrême beauté, remontant au début du VIIe siècle) et par le simple fait que les musulmans postérieurs n'auraient eu aucun intérêt à fabriquer des textes annonçant la fin du monde alors que celle-ci n'avait pas eu lieu, car cela aurait décrédibilisé inutilement la parole du Prophète.
- L'attribution et la datation des autres sourates posent plus de problèmes. Certains historiens pensent que le Coran comporte des textes antérieurs au Prophète, qui auraient appartenu à des traditions bibliques préexistantes avant d'être adaptés en arabe et intégrés au corpus coranique. On considère aussi que d'autres textes n'ont pas pu être produits avant les conquêtes et la constitution de l'empire arabe, dans la seconde moitié du VIIe siècle, et ont donc été rajoutés plus tard, après la mort du Prophète.
- L'Histoire : De quand date la version officielle du Coran telle que nous la connaissons aujourd'hui ?
- Selon la tradition musulmane, la version officielle du Coran remonte à l'époque du troisième calife, Uthman (644-656), soit deux décennies à peine après la mort du Prophète, d'où le nom de « Vulgate uthmanienne » qui lui est parfois donné.
- Si l'on peut admettre qu'une partie du texte a effectivement été élaborée sous le califat d'Uthman, les dernières hypothèses tendent plutôt à situer la compilation officielle sous le règne du cinquième calife omeyyade, Abd al-Malik (685-705), soit environ soixante-dix ans après la mort de Muhammad. Certains considèrent même Abd al-Malik comme le véritable fondateur de l'islam en tant que religion officielle de l'empire, ce qui se justifie à la fois par l'oeuvre législative et cultuelle considérable de ce souverain, et par la violence avec laquelle il chercha à unifier l'empire dont le Coran se fait peut-être l'écho. En effet, durant le demi-siècle qui sépare le règne d'Uthman de celui d'Abd al-Malik, le monde musulman a connu des transformations majeures (intensification des guerres civiles, poursuite de la conquête, constitution de l'empire arabe) à l'origine d'un véritable changement de paradigme : en seulement quelques décennies, on est passé du contexte de l'Arabie tribale, qui a vu naître le Prophète, à celui d'un immense empire s'étendant de l'Afrique du Nord à l'Asie centrale, sur lequel règne un calife qui se présente comme le successeur de Muhammad et le chef de l'islam.
- Aux confins du VIIe-VIIIe siècle de notre ère, Abd al-Malik est le premier des grands califes omeyyades qui entreprend l'arabisation des structures impériales, avec l'adoption de l'arabe comme langue de l'administration, et de la législation : il est notamment à l'origine d'un certain nombre de lois concernant les terres des peuples conquis, ou le statut des Juifs et des chrétiens. On retrouve aussi son nom dans maints textes relatifs à l'élaboration du Coran, ce qui nous autorise à penser qu'il a été initiateur de la compilation officielle.
- L'Histoire : Comment expliquer dès lors que la tradition ait plutôt retenu le nom de son prédécesseur Uthman ?
- L'explication est probablement d'ordre politique. Comme l'écrivait Alfred-Louis de Prémare2, le grand islamisant français décédé en 2006, c'est sans doute Abd al-Malik lui-même qui a choisi de faire remonter la rédaction du Coran à Uthman, le premier calife omeyyade de l'Islam, afin de légitimer le pouvoir de la dynastie des califes issue de cette famille, en l'associant à la version officielle du texte le plus saint de l'islam. Cela ne veut pas dire pour autant que tous les musulmans ont accepté cette version « califale ». Le calife avait beaucoup d'ennemis, notamment les « protochiites », partisans d'Ali, qui contestaient la légitimité des Omeyyades à se présenter comme les successeurs du Prophète. L'acceptation de la version califale par tous les musulmans a pris en réalité plusieurs siècles et, jusqu'au début du Xe siècle de notre ère, au moins quatre versions différentes du Coran ont continué à circuler.
- L'Histoire : Le Coran a donc été en partie façonné par et pour l'empire. En amont, est-ce que le message coranique a été un facteur décisif des conquêtes arabes ?
- La plupart des historiens, et je me reconnais dans cette idée, pensent qu'ajouter foi à une religion, c'est-à-dire à un ensemble de pratiques et de lois, prend beaucoup de temps. Une population tout entière ne devient pas croyante du jour au lendemain. Or, les conquêtes arabes ont commencé très peu de temps après la mort du Prophète, bien avant que les croyances qu'il prêchait aient vraiment eu le temps de s'enraciner. Nous sommes donc beaucoup à mettre en doute le rôle de la foi dans la dynamique des conquêtes arabes.
- Sur ce point, Karl-Friedrich Pohlmann, un grand historien des religions allemand, a mis en lumière un fait extrêmement important. Éminent bibliste avant de devenir coraniste, il a appliqué un certain nombre de méthodes de la critique biblique aux sourates « guerrières » du Coran, les sourates VIII et IX. Ce qu'il a montré, c'est que Muhammad avait très probablement deux groupes de fidèles. Le premier rassemblait les croyants originels, qui ajoutaient foi au message premier de Muhammad proclamant la fin imminente du monde et demandant aux hommes de se repentir et de s'entraider les uns les autres. La notion de guerre sainte n'intervient jamais chez eux. Ce sont des gens pacifistes et non militants, probablement très proches des Juifs et des chrétiens de leur entourage. Le second groupe rassemble ceux que le Coran appelle les « hypocrites », c'est-à-dire les Mecquois qui se sont convertis au message de Muhammad par opportunisme, après avoir été vaincus par les armes. A la différence des premiers, ces hommes sont des militants, qui pensent que les Arabes doivent préparer le monde au Jugement dernier par les armes, le butin et la conquête.
- Je pense qu'on peut rapprocher cette division entre compagnons militants et non militants de ce qu'on connaît par ailleurs de la famille immédiate du Prophète, les Banu Hachim, qui s'occupaient des affaires religieuses à La Mecque, et les Omeyyades, membres de la même grande tribu des Quraych, qui s'occupaient plutôt des affaires économiques et des questions politiques. Ce sont ces hommes, ralliés à Muhammad surtout au moment de sa conquête de La Mecque en 630, qui ont pris le pouvoir à sa mort. En vertu de cette hypothèse, qui est étayée de manière très rigoureuse et érudite par Pohlmann, ces gens-là étaient à la recherche de butin avant même leur conversion, et n'ont fait que profiter de l'aura du Prophète pour assouvir leur soif de conquête.
- L'Histoire : Vous êtes vous-même un spécialiste de la genèse du chiisme. Pourriez-vous nous expliquer en quoi celle-ci est liée à l'écriture du Coran et aux premières rivalités entre musulmans ?
- Parmi tous les courants qui ont, dans un premier temps, refusé la version officielle du Coran, les protochiites sont ceux qui ont adressé la critique la plus virulente à celle-ci. Même après le Xe siècle, quand en apparence tous les musulmans ont accepté la version officielle, il y a toujours eu un courant souterrain dans le chiisme pour soutenir la thèse ancienne de la falsification du Coran, et ce jusqu'à maintenant.
- Pour expliquer ce phénomène, il faut en revenir au message même du Prophète. Souvenez-vous : Muhammad est venu principalement annoncer la fin du monde, et il appartenait à une tradition biblique. Logiquement, il aurait également dû annoncer la venue du Messie, du Sauveur de la fin du monde. Or, curieusement, la figure du Messie est absente du Coran. Jésus est certes appelé Al-Masih, mais rien n'est dit de ce mot extrêmement chargé. A l'inverse, dans le hadith, le Prophète parle beaucoup de l'avènement du Sauveur, qui est même assimilé à Jésus dans les strates anciennes du hadith. C'est seulement plus tard, très probablement sous Abd al-Malik, que la figure du Sauveur a été arabisée et est devenue aux yeux des sunnites l'un des descendants indéterminés du Prophète. Par ailleurs, le Coran ne dit rien sur les contemporains de Muhammad.
- Comment expliquer ce silence majeur ? C'est là qu'interviennent les chiites et leur critique de la version officielle. Pour eux, la dimension messianique était bien présente dans le message originel du Prophète. Certains textes chiites anciens affirment même que plusieurs compagnons du Prophète, membres du premier groupe de croyants non militants, considéraient qu'Ali, son cousin germain et son gendre, l'époux de sa fille aînée Fatima et le père de ses deux seuls petits-fils, Hasan et Husayn, était une nouvelle manifestation de Jésus, le Sauveur lui-même. Les chiites sont les descendants de ces premiers partisans d'Ali, et considèrent celui-ci comme leur premier imam, le saint par excellence, la manifestation la plus exemplaire des attributs de Dieu. Pour eux, la mention de la dimension messianique du message de Muhammad, appliquée en particulier à Ali, a été effacée du Coran au moment de la compilation officielle par les membres du second groupe de croyants militants, ces « hypocrites » qui se sont emparés du pouvoir à la mort du Prophète en écartant Ali, et qui ont fondé l'Empire omeyyade au terme de plusieurs décennies de guerre civile.
- En effaçant cet aspect, les adversaires d'Ali auraient cherché non seulement à cacher son statut particulier dans le message du Prophète, mais également à faire oublier que ce dernier avait annoncé la fin imminente du monde, un monde qu'ils avaient depuis conquis et qu'ils n'avaient dès lors plus aucun intérêt à voir disparaître.
- A l'inverse, cette dimension messianique originelle est restée bien vivante dans le chiisme, même après la mort d'Ali, dont le statut messianique a été transmis à ses descendants, les imams, parmi lesquels est censé apparaître le Sauveur.
- Pour ces chiites, les suppressions et ajouts postérieurs expliqueraient le caractère déstructuré et fragmentaire du Coran tel qu'on le connaît aujourd'hui, et permettraient également de comprendre l'absence presque totale des contemporains du Prophète contrairement à un élément très présent dans les autres textes de la tradition biblique.
- Cependant, il ne s'agit là que de la thèse défendue par les sources chiites, qui sont tout aussi orientées que les sources sunnites dites orthodoxes. Ce qui est important, c'est de les prendre en compte, ce que ne faisait pas jusqu'à il y a quelques décennies l'islamologie, restée fidèle au cadre fixé par l'orthodoxie sunnite. Or il est toujours intéressant de considérer le point de vue des vaincus de l'histoire, qui dans le cas présent permet d'expliquer un certain nombre de contradictions des vainqueurs. Et ce d'autant que la base de la thèse chiite va dans le même sens que les historiens, puisqu'elle affirme que le Coran s'inscrit dans l'histoire, que le texte coranique a été rédigé dans un contexte de guerre civile, marqué par une connivence entre les milieux du pouvoir califal et des lettrés, et que cette rédaction a pris du temps et a impliqué plusieurs rédacteurs.
- L'Histoire : Vous insistez beaucoup sur le décalage entre ce que dit le Coran et ce qu'on lui a fait dire par la suite. Comment le texte a-t-il été interprété par la tradition savante de l'islam médiéval ?
- Dès le départ, les savants musulmans ont présenté le Coran comme la parole divine, le fruit de la Révélation. Mais ils ont aussi très rapidement pris conscience du caractère problématique du texte. C'est ce que prouve l'élaboration très précoce des sciences coraniques dès les trois premiers siècles de l'islam, qui visaient une meilleure compréhension du Coran.
- L'une d'entre elles étudie la composition du Coran, dont elle aspire à justifier la structure décousue et désarticulée, en réponse aux critiques que les savants juifs et chrétiens adressaient à l'islam dans le cadre des grandes controverses théologiques de l'époque. Or, quand on regarde les livres qui composent ce genre littéraire, on s'aperçoit que chaque auteur a donné une explication différente à l'organisation du texte.
- Autre science coranique : celle des circonstances de la Révélation (asbab al-nuzul), qui cherchait à expliquer dans quelles circonstances « historiques » (une bataille, une querelle familiale, un événement quelconque, etc.) telle ou telle sourate, tel ou tel verset, avait été révélé. Là encore, les auteurs ont apporté des réponses très diverses : parfois, pour un même verset, il y a jusqu'à quatorze circonstances de révélation différentes. De même pour la science de l'abrogation, qui visait à expliquer les contradictions nombreuses contenues dans le texte, par exemple concernant la consommation de vin, présenté tour à tour comme une boisson paradisiaque, au même titre que le lait et le miel, comme une boisson dont la consommation est interdite seulement au moment de la prière, et comme une boisson démoniaque totalement proscrite. Pour surmonter ces contradictions, la science de l'abrogation postulait qu'un verset récent abrogeait les versets plus anciens lorsqu'il entrait en contradiction avec ces derniers. Cela a posé beaucoup de problèmes théologiques aux musulmans, qui ne comprenaient pas comment Dieu pouvait changer d'avis sur un sujet donné. Et puis, selon les auteurs, le nombre des versets abrogeants et abrogés variait de 3 à 400.
- Tout cela montre que le Coran était éminemment problématique pour les musulmans. Mais, à mon sens, les lettrés ont su faire de cette faiblesse une vraie force. Pour comprendre leur texte sacré ils sont allés chercher des clés de lecture dans d'autres cultures, chez les Juifs, les chrétiens, les manichéens, les Grecs, les Iraniens, etc. Par là, ils ont fait de l'islam une culture exégétique. Or on sait que le besoin exégétique est un facteur civilisateur : à partir du moment où l'on recourt à l'exégèse, c'est qu'on considère qu'un texte ne se limite pas à sa littéralité, qu'il a plusieurs strates de sens, dont l'interprétation nécessite de faire varier les points de vue. C'est de cette distance par rapport à la lettre que naît la culture.
- L'Histoire : A partir de quand les savants ont-ils commencé à faire une lecture historique et critique du Coran ?
- Les premières études historico-critiques, fondées sur l'histoire et la philologie, remontent à la première moitié du XIXe siècle, en Allemagne. Elles ont été l'oeuvre de savants, majoritairement juifs, qui avaient une très bonne connaissance de la Bible et des langues bibliques - l'hébreu, le grec et le syriaque. Ces biblistes se sont, tout d'abord, intéressés au Coran en raison des parallèles qu'ils y trouvaient avec les textes bibliques. Le pionnier d'entre eux est sans doute Abraham Geiger, auteur de la première grande étude philologique du Coran. Par la suite, Theodor Nöldeke et ses disciples ont écrit une somme monumentale sur l'histoire du Coran, la Geschichte Des Qorans, qui est rapidement devenue un classique du genre.
- Au siècle suivant, deux grands tournants ont été pris par les études coraniques. Le premier s'est produit dans les années 1970, en Allemagne, avec Günter Lüling, en Angleterre, avec l'Américain John Wansbrough, puis la Danoise Patricia Crone et le Britannique Michael Cook. Les écrits de ces savants ont fait couler beaucoup d'encre, mais ils ont eu le mérite de mettre sur pied des repères méthodologiques et épistémologiques solides qui restent toujours valables. Ils ont notamment montré que les sources islamiques ne sont pas fiables sur les origines de l'islam et du Coran, qu'elles sont pleines de contradictions, d'invraisemblances et de légendes. Cela ne veut pas dire qu'il faut les rejeter, mais qu'il faut les lire avec prudence critique, en prêtant attention à leurs contradictions. L'autre apport majeur des années 1970, c'est qu'il est nécessaire d'intégrer l'étude tout aussi critique des sources non islamiques contemporaines des débuts de l'islam, zoroastriennes, juives et chrétiennes, qui constituent souvent des contrepoints utiles aux textes islamiques postérieurs.
- Le second tournant s'est produit dans les années 2000, avec la mise en évidence de l'influence clé du christianisme de langue syriaque dans l'écriture du Coran, et avec l'intégration de l'histoire matérielle (archéologie, épigraphie, paléographie, codicologie), dont les représentants mènent aujourd'hui un dialogue fécond avec les historiens et les philologues islamisants.
- L'Histoire : L'ouvrage que vous venez de diriger avec Guillaume Dye,Le Coran des historiens , est l'héritier de ces nouvelles recherches. Quels sont les objectifs de cette somme monumentale ?
- Le premier objectif est d'offrir une synthèse des recherches depuis le XIXe siècle et la naissance des études coraniques, mais surtout depuis le tournant des années 1970. Elle s'imposait à nos yeux, dans la mesure où les avancées des années 2000 ont donné lieu à une explosion du nombre de publications dans le domaine des études coraniques, avec la création de groupes de recherche un peu partout dans le monde, rassemblant des savants de diverses disciplines, dont certains fournissent des travaux de très grande qualité, d'autres un peu plus discutable.
- Mais, au-delà de la synthèse, l'ouvrage se veut aussi une reconnaissance de dette intellectuelle à l'égard des savants du XIXe et du début du XXe siècle, qui ont joué un rôle majeur dans la fondation des études coraniques mais dont les noms avaient parfois été injustement oubliés. Je pense par exemple à Paul Casanova, professeur au Collège de France dans les années 1900, qui a été très en avance sur son époque. Ce qu'il disait a été balayé par les autres islamologues de son temps, parce qu'il insistait sur la dimension apocalyptique du message de Muhammad, sur laquelle on a tendance à revenir aujourd'hui. Son ouvrage Mohammed et la fin du mondeest d'une importance cruciale dans les études sur l'origine de l'islam. En plus de cette synthèse, notre livre présente au public les dernières recherches sur le Coran.
- Le deuxième objectif est en quelque sorte politique. Le Coran des historiens vient compléter l'éclairage apporté par le Dictionnaire du Coranque j'avais dirigé en 2007 chez Robert Laffont, qui s'inscrivait déjà dans une démarche civique. A la suite des attentats de 2001, certains cherchaient à imposer une vision très monolithique de l'islam : soit une religion de conquête et de violence chez les polémistes, soit une religion de salut pour tous chez les apologètes. L'idée du Dictionnaire était de sortir de cette confrontation binaire en soulignant la très grande diversité des représentations et des interprétations du Coran par les musulmans (théologiens, exégètes, juristes, mystiques, etc.). Le Coran des historiens apporte un éclairage complémentaire, en s'intéressant non pas à ce que disent les musulmans de leur texte sacré, mais à ce qu'il s'est passé avant et pendant l'établissement du corpus coranique, au « Coran avant l'islam ». Nous avons ainsi voulu appliquer un regard philologique, critique et distancié au Coran, bien sûr dans le plus grand respect de l'objet et de ceux qui y croient.
- Souvent, les étudiants et les musulmans croyants avec qui je discute me demandent si cette approche ne constitue pas une menace pour leur foi. En guise de réponse, je fais généralement référence à quelques grands penseurs de l'islam, en particulier Al-Ghazali, un théologien sunnite du XIe-XIIe siècle, et Ibn Arabi, un grand mystique du XIIe-XIIIe siècle. Ces penseurs ont fait une distinction entre la croyance et la foi, affirmant que la foi peut être polluée par un certain nombre de croyances, et que pour consolider celle-ci il faut en partie abandonner celles-là. La foi est quelque chose de très énigmatique, de l'ordre du sentiment intérieur, presque de l'amour. La croyance, elle, relève de l'histoire et découle de la culture, de l'éducation, de ce que nous transmet notre entourage. Je pense qu'une démarche historico-critique peut porter atteinte à un certain nombre de croyances, mais pas à la foi. Elle permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire, d'éliminer les croyances accessoires pour mieux préserver la foi essentielle. En ce sens, l'histoire ne menace pas la foi. Elle peut même la consolider.
- ==
- Directeur d'études à l'École pratique des hautes études (EPHE), Mohammad Ali Amir-Moezzi a notamment dirigé le Dictionnaire du Coran (Robert Laffont, 2007) et, avec Guillaume Dye, Le Coran des historiens (Cerf, 2019). Son Coran silencieux et le Coran parlant. Sources scripturaires de l'islam entre histoire et ferveur vient d'être publié en poche (CNRS Éditions, [2011], 2020).
Add Comment
Please, Sign In to add comment