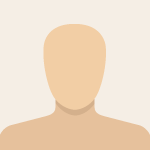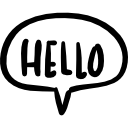Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- JEAN-PIERRE OBIN, La déscolarisation des élèves juifs de l’enseignement public français
- Commentaires 157 (2017)
- INSPECTEUR général de l’Éducation nationale dans le groupe « Établissements et vie scolaire » de 1990 à 2008, j’ai été un observateur privilégié des évolutions culturelles et sociales que les établissements scolaires ont connues durant ces quelque vingt années. C’est dans ce cadre institutionnel que j’ai conduit durant l’année scolaire 2003-2004, à la demande de Luc Ferry, alors ministre chargé de l’Éducation nationale, une enquête sur « Les signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires », au cours de laquelle j’ai été assisté de dix inspecteurs généraux de mon groupe. Ce travail s’est conclu par la remise en juin 2004 d’un rapport (1) à François Fillon, successeur de Luc Ferry à la tête du ministère, qui, après l’avoir tenu secret, a décidé de le rendre public en mai 2005 (2).
- Ce rapport mettait en évidence les phénomènes préoccupants qui prenaient de l’ampleur dans les collèges et les lycées implantés dans des quartiers particulièrement défavorisés, regroupant de fortes proportions de populations immigrées et issues d’une immigration récente : contestation de certains enseignements et de certaines formes de pédagogie, refus de règles de la vie scolaire, atteintes aux personnes et aux biens et, parmi ces dernières, essor de l’antisémitisme. Notre constat sur ce point était très alarmant et a été repris par certains médias. Voici précisément ce que nous écrivions pour conclure ce chapitre : « Quoi qu’il en soit, si le racisme le plus développé dans la société reste le racisme antimaghrébin, ce n’est plus le cas dans les établissements scolaires, où il a été très nettement supplanté par le racisme antijuif. Il est en effet, sous nos yeux, une stupéfiante et cruelle réalité : en France les enfants juifs – et ils sont les seuls dans ce cas – ne peuvent plus de nos jours être scolarisés dans n’importe quel établissement. »
- Dans une première partie, plus subjective, je vais expliquer comment j’ai été amené à prendre conscience de ce phénomène et, dans une seconde, comment ces observations personnelles peuvent être confirmées par quelques données objectives.
- Témoignage
- C’est en 1991, à l’occasion de la première guerre du Golfe, que j’entendis parler pour la première fois, par des chefs d’établissement de l’académie de Lyon, d’une véritable mutation dans le comportement de certains élèves d’origine maghrébine, lesquels manifestaient ouvertement leur contestation radicale de la politique française et leur hostilité à la France et proclamaient publiquement, dans leur collège ou leur lycée, leur soutien à l’ennemi de l’époque, Saddam Hussein.
- Un peu plus tard, en écho à la première intifada, j’entendis parler, sans plus de détails, d’« incidents » entre élèves juifs et « arabes » dans des cours de récréation. Mais c’est en 1996 que je pris conscience de manière brutale de ce qui était en train de se passer dans le silence général. J’enquêtais alors dans certains collèges de l’académie de Lyon dans le cadre d’une mission d’évaluation de la politique d’éducation prioritaire. J’étais ce jour-là au collège Henri-Longchambon, situé dans le quartier des États-Unis à Lyon, un quartier d’habitat populaire très mixte construit en partie pour accueillir en 1962 les rapatriés d’Algérie. Le principal, Jean-Paul Chiche, me confia qu’il venait de voir partir, sans avoir pu les retenir, « les deux derniers élèves juifs du collège». Il me raconta alors l’histoire du départ progressif, les années précédentes, de l’ensemble des élèves de la communauté juive du quartier, soumis au harcèlement physique et moral de certains de leurs condisciples. Il me fit part de sa détermination à faire cesser ces exactions en réunissant plusieurs conseils de discipline, mais de son impuissance à arrêter les violences à l’extérieur, sur le chemin de l’école. Il me dit également le désarroi des parents, dont certains se résignaient à inscrire leur enfant dans un établissement privé, mais qui, pour les plus « républicains » d’entre eux, choisissaient de rester dans l’enseignement public ; ceux-là recevaient alors le concours d’autorités académiques « compréhensives » mais discrètes, qui leur permettaient d’inscrire leur enfant, même en cours d’année, dans un collège « protégé » du centre-ville.
- Je fus personnellement très choqué par cette découverte et en alertai de manière circonstanciée, dans ma note de synthèse sur l’académie de Lyon, les deux rapporteurs nationaux. Je n’en retrouvai nulle trace dans le rapport national (3), ce qui ne fut pour moi qu’une demi-surprise, tant je connaissais la tendance de l’institution à dissimuler des faits déplaisants afin de préserver l’image de l’école publique ou, comme on dit de nos jours, à « communiquer », autrement dit à livrer une version édulcorée et édifiante de certains faits plutôt que d’en informer honnêtement le public. C’est une des raisons pour lesquelles, en 2003, j’ai convaincu mes collègues du groupe « Établissements et vie scolaire » de demander au ministre une mission portant sur l’ensemble des dérives politico-religieuses affectant certains établissements, et dont l’écho commençait à se faire entendre dans les médias et dans certains rapports officiels.
- Concernant la question de la déscolarisation des élèves juifs, notre constat a été triple.
- 1) Le départ de ces élèves était toujours discret, le souci de sécurité des familles rejoignant ici la pusillanimité atavique de l’institution (« surtout, pas de vagues »). Certaines familles se dirigeaient vers l’enseignement privé laïque et catholique et d’autres vers des établissements publics socialement privilégiés, les uns et les autres n’accueillant que peu de familles issues de l’immigration. L’enseignement privé juif recevait aussi certains élèves, mais sa capacité d’accueil était limitée, la montée en charge de son offre forcément lente et sa répartition sur le territoire très inégale.
- 2) Des élèves juifs restaient toutefois scolarisés dans certains collèges socialement mixtes au prix de la dissimulation de leur judéité. Je reçus sur ce point le témoignage de la principale d’un collège de Bourg-Saint-Andéol, en Ardèche, me confiant qu’elle était la seule à savoir que deux de ses élèves étaient juifs, lesquels autrement n’auraient pas pu rester dans son établissement.
- 3) Enfin, la résignation, voire l’indifférence, de beaucoup d’enseignants et de responsables à ces départs nous ont frappés et parfois choqués : ainsi de ces enseignants, interrogés par un de mes collègues sur les circonstances du départ des élèves juifs de leur lycée, lui répondant que ces enfants étaient partis car « ils n’étaient pas assez nombreux pour se défendre ».
- Ajoutons que des professeurs présumés juifs par leurs élèves pouvaient être, eux aussi, la cible de manifestations d’antisémitisme.
- Face aux faits rapportés, de rares réactions hostiles se manifestèrent au sein de l’inspection générale, sous la forme du déni ou de la relativisation de la gravité de certains faits, et de l’accusation implicite d’« islamophobie » à mon encontre.
- Aujourd’hui, les établissements et leurs responsables sont davantage sensibilisés à la question de l’antisémitisme, mais la séparation entre les élèves juifs et ceux issus des immigrations maghrébine, turque, comorienne et sahélienne est quasiment achevée. Elle n’est d’ailleurs qu’une composante du séparatisme scolaire et résidentiel plus général observé par certains sociologues. Esther Benbassa, devenue depuis sénatrice, chantre du communautarisme et de la préservation de la « diversité ethnique » de la France (4), en faisait d’ailleurs un remède à l’antisémitisme dans son commentaire de notre rapport en 2006 : « Dans les “ghettos”, écrivait-elle, les élèves juifs sont plutôt scolarisés dans des écoles juives, ce qui contribue à réduire les cas d’antisémitisme (5). »
- Quelques données objectives
- Je m’appuie ici sur trois études : celle de Nonna Mayer et Guy Michelat effectuée en 2004 pour la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) (6), celle d’Erik Cohen en 2007 pour le Fonds social juif unifié (FSJU) (7) et celle de Noémie Grynberg de 2010 (8). Je remercie également Patrick Petit-Ohayon pour les informations complémentaires qu’il m’a apportées. Quels constats tirer de ces études et des données ainsi rassemblées ?
- 1) L’antisémitisme en France ne se réduit certes pas à l’impact du conflit israélo-palestinien, mais la variation des opinions comme la flambée des actes antisémites, y compris en milieu scolaire, apparaissent directement liées aux événements du Proche-Orient. Ainsi, les actes antisémites passent de 0 en septembre à 100 en octobre 2000 (Ariel Sharon sur l’esplanade des Mosquées) et de 10 en février à 120 en avril 2002 (opération « Remparts » de l’armée israélienne à Jénine). Dans l’enseignement public, en 2004, 30 % des actes de violence raciste signalés ont touché des élèves juifs, alors que la proportion de ces derniers dans la population scolaire est environ cent fois moindre.
- 2) On évalue (sur une base déclarative) le nombre de juifs français à environ 500 000 personnes, ce qui représente à peu près 100 000 enfants scolarisés entre 6 et 18 ans. Selon les estimations du FSJU, un tiers de ces enfants est inscrit dans l’enseignement juif hors contrat et sous contrat, un autre tiers resterait scolarisé dans l’enseignement public et le tiers restant se répartirait dans des établissements privés sous contrat, laïques et catholiques.
- 3) En 2015, les établissements juifs accueillaient 31500 élèves, dont 25000 dans des classes sous contrat, contre 8 000 en 1978 et 400 en 1950. La montée continue et progressive de l’offre d’enseignement juif depuis la Libération a rencontré deux périodes de forte demande de la part des familles : après 1968, pour des raisons d’ordre scolaire, et depuis 1990 pour des motifs de sécurité. Toutefois, l’attente des familles vis-à-vis de l’enseignement juif ne se borne pas à ces motivations conjoncturelles, qui ne font que s’ajouter aux deux raisons traditionnelles du choix de l’école juive que sont l’enseignement hébraïque et l’éducation religieuse.
- Depuis 2008, on observe un reflux de la scolarisation, moins important cependant que le flux d’arrivées de nouvelles familles, lequel est constant. Les motivations des familles partantes sont diverses : le niveau jugé médiocre de l’enseignement, des pédagogies estimées archaïques, l’orthodoxie religieuse, des frais de scolarité élevés... À cela s’ajoute, depuis les assassinats de Toulouse en 2012, la crainte que les enfants scolarisés dans des écoles juives ne deviennent des cibles désignées pour les terroristes. Aussi, à la rentrée de 2015, l’enseignement juif accuse-t-il pour la première fois une perte nette de 600 élèves : environ 1 600 départs pour 1 000 arrivées, en grande majorité en provenance de l’enseignement public. Le sentiment se développe chez certains parents que, davantage que par une protection militaire, parfois traumatisante pour les enfants, leur sécurité sera mieux assurée s’ils sont anonymement « noyés dans la masse » des élèves du public.
- 4) L’examen par le FSJU des motifs de départ de l’enseignement juif en 2015 a fait apparaître que, dans une forte majorité, il s’agissait de familles quittant la France (pour Israël et l’Amérique du Nord surtout), ainsi que de familles déménageant vers des zones résidentielles et socialement favorisées dans lesquelles les établissements publics ou privés sont réputés sûrs. Ainsi, dans la région parisienne, on observe deux flux internes de migrations de familles juives – et donc de regroupement – vers le nord-ouest et le sudest de l’agglomération. De ce point de vue, les familles juives ne se distinguent guère des autres familles françaises qui adoptent depuis longtemps des stratégies résidentielles, parfois sophistiquées, afin de choisir la « bonne école » pour leurs enfants (9). Ces stratégies, inaugurées par les classes supérieures, ont massivement mobilisé les classes moyennes depuis trente ans et touchent désormais les classes populaires. Selon certaines études, ce mouvement vers l’entre-soi scolaire s’opère dorénavant principalement sur une base ethnosociale (10).
- L’histoire retiendra peut-être que cinq cents ans précisément après l’expulsion des juifs d’Espagne et du Portugal l’école française a connu une vague de départs des élèves juifs de certains établissements scolaires publics sous l’effet de la violence, de la menace et de la peur.
- Et cela dans un silence assez général dû sans doute à la pusillanimité de l’Éducation nationale, au lien direct avec des événements survenus à l’étranger et à la culpabilité refoulée des Français. Les assassinats ciblés sur le sol français de juifs et d’enfants juifs, à côté d’autres Français semblent aujourd’hui changer la donne, modifier les stratégies des familles et faire sortir les responsables et les médias de leur indifférence.
- JEAN-PIERRE OBIN
- Notes:
- 1. Jean-Pierre Obin, Les Signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires, rapport au ministre de l’Éducation nationale, La Documentation française, 2004. www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000509 -les-signes-et-manifestations-d-appartenance-religieuse-dans-lesetablissements-scolaires.
- (2) Sur l’histoire de la publication de ce rapport, voir Annette Coulon, « Le rapport Obin, la gauche et l’extrême droite », in Alain Seksig, Michèle Narvaez, Barbara Lefebvre et al., L’École face à l’obscurantisme religieux, Max Milo, 2006.
- (3) Catherine Moisan et Jacky Simon, Les Déterminants de la réussite scolaire en ZEP, rapport au ministre de l’Éducation nationale, 1997.
- (4) Esther Benbassa, Eva Joly et Noël Mamère, « Manifeste pour une écologie de la diversité », Libération, 27 janvier 2011.
- (5) Esther Benbassa, « Pour une école des différences », in Alain Seksig, Michèle Narvaez, Barbara Lefebvre et al., L’École face à l’obscurantisme religieux, op. cit.
- (6) Nonna Mayer et Guy Michelat, La Lutte contre le racisme et la xénophobie, rapport 2004 de la CNCDH, La Documentation française, 2006.
- (7) Erik H. Cohen, Heureux comme juifs en France ?, Akadem, 2007.
- (8) Noémie Grynberg, Le Choix de l’école juive en France : une question d’identité, 2010. www.noemiegrynberg.com/pages/ communaute/le-choix-de-l-ecole-juive-en-france-une-question-didentite.html.
- (9) Robert Ballion, La Bonne École : évaluation et choix du collège et du lycée, Hatier, 1991.
- (10) Agnès Van Zanten et Jean-Pierre Obin, La Carte scolaire, PUF, « Que sais-je ? », 2010.
Add Comment
Please, Sign In to add comment