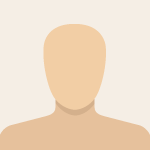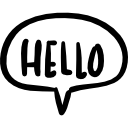Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- « Pendant les premiers siècles de l’islam, il existait plusieurs versions du Coran »
- Le Monde, dimanche 22 janvier 2023
- Cyprien Mycinski
- Quand le Coran a-t-il été mis par écrit ? N’y a-t-il d’ailleurs toujours eu qu’un seul Coran ? Quelles sont ses influences littéraires, culturelles ou religieuses ? L’historien Mohammad Ali Amir-Moezzi revient aux sources de l’énigmatique livre sacré de l’islam, dans un entretien au « Monde ».
- Mohammad Ali Amir-Moezzi est directeur d’études en islamologie à l’Ecole pratique des hautes études, à Paris. Codirecteur, en 2019, du Coran des historiens (Cerf, 4 372 pages, 89 euros), ouvrage monumental réunissant trente éminents spécialistes de l’islam, il vient de copublier L’Histoire du Coran (Cerf, 1 092 pages, 34 euros), qui synthétise, complète et met à jour une partie des textes du premier.
- Ce dernier livre s’intéresse tout particulièrement au contexte historique, politique, religieux et culturel qui a vu naître le Coran, placé à la croisée des nombreuses traditions et religions de l’Antiquité tardive, à commencer par le judaïsme et le christianisme oriental. Le chercheur résume les dernières avancées de la recherche sur l’énigmatique livre sacré des musulmans.
- Que sait-on de la date de rédaction du Coran ?
- Pour les musulmans, le Coran est la Parole de Dieu révélée à Muhammad [Mahomet, 571-632]. Elle est transmise au Prophète par l’ange Gabriel, qui lui apparaît à de multiples reprises pendant une vingtaine d’années. Au fur et à mesure qu’il reçoit cette révélation, Muhammad la dicte à des copistes. Quelques années après sa mort, alors qu’Othman est devenu calife [il règne entre 644 et 656], les multiples fragments de la révélation sont réunis en un livre unique. Voilà ce qu’est le Coran selon la tradition musulmane.
- Reste qu’un historien doit d’emblée insister sur un point : selon les sources musulmanes elles-mêmes, pendant les quatre premiers siècles de l’islam, il existait plusieurs versions du Coran. Ce n’est qu’au IVe siècle de l’hégire [début du calendrier islamique], c’est-à-dire au Xe siècle de l’ère chrétienne, que le Coran « officiel », celui qui aurait été transcrit sous Othman, s’impose comme la seule et unique version du texte.
- Jusque-là, les musulmans étaient divisés en plusieurs factions hostiles, et les affrontements avaient notamment pour enjeu le contenu du livre sacré. Depuis que le Coran othmanien s’est imposé chez tous les musulmans, les versions divergentes ont disparu. Le récit orthodoxe les a effacées.
- Comment ce Coran d’Othman s’est-il imposé comme unique version du texte sacré ?
- Jusqu’au Xe siècle, de nombreux groupes – et avant tout les chiites – mettent en question le Coran d’Othman. Or, à cette date, ces derniers parviennent à prendre le pouvoir dans l’empire musulman. Les nouveaux dirigeants chiites comprennent très vite combien les sunnites, qui sont majoritaires, sont attachés à cette version du livre. Pour éviter que les masses sunnites ne se révoltent contre eux, ils gomment donc leurs caractéristiques les plus explicitement chiites.
- Ils ne font ainsi plus mention de la thèse de la falsification du Coran othmanien, selon laquelle certains passages du texte révélé auraient été supprimés. Paradoxalement, c’est une forme d’autocensure chiite qui a donc permis au Coran d’Othman de s’imposer comme seule et unique version du texte sacré.
- Selon la tradition, le Coran d’Othman aurait donc été élaboré à partir des multiples fragments de la révélation pris en note à l’époque de Muhammad. Qu’en disent les historiens ?
- Commençons par dire que le Coran est un ouvrage d’une grande complexité. C’est un corpus plus qu’un livre, au sens où il réunit des textes très différents les uns des autres qui se succèdent et se mélangent sans logique narrative. On y retrouve des prières, des préceptes moraux ou juridiques, des histoires, comme celles de Moïse ou d’Abraham, qui sont coupées en morceaux dispersés tout au long du texte coranique… Cela rend très difficile la datation des différentes parties.
- Pour autant, de plus en plus de spécialistes considèrent aujourd’hui que le Coran que l’on connaît n’a pas été élaboré sous Othman comme le dit la tradition, mais plutôt sous Abd Al-Malik, calife de 685 à 705.
- Certains morceaux du Coran remonteraient à Muhammad lui-même
- On se situe alors après les premières grandes conquêtes arabes, et ce calife gouverne un territoire gigantesque qui s’étend de la Libye aux confins de la Chine. La situation est donc radicalement différente de celle qui prévalait à l’époque de Muhammad ou d’Othman, lesquels vivaient dans un contexte qui demeurait local et tribal.
- Abd Al-Malik semble habité par une ambition impériale : il entend faire des terres conquises un empire unifié. Il impose par exemple des poids et mesures communs, ou bien fait de l’arabe la langue « officielle » de l’administration.
- Or un véritable empire doit avoir sa religion propre. L’empire byzantin a le christianisme, l’empire perse sassanide le zoroastrisme, et son empire à lui aura l’islam. Dans cette optique, il aurait rendu publique une version « officielle » du Coran. Simplement, il n’en revendique pas la paternité pour lui-même. Il proclame en effet que c’est sous Othman que cette version fut élaborée. S’il fait cela, c’est probablement parce qu’Othman appartenait comme lui à la dynastie omeyyade : faire du calife Othman le père du livre saint est donc un moyen de légitimer le pouvoir de sa propre famille.
- Dans le Coran, peut-on repérer diverses couches correspondant à diverses époques de rédaction, depuis Muhammad jusqu’à Abd Al-Malik ?
- Selon beaucoup de spécialistes, certains morceaux remonteraient à Muhammad lui-même. C’est par exemple le cas de l’apocalyptique coranique, c’est-à-dire l’évocation de la fin du monde, que l’on retrouve dans les 30-35 dernières sourates. Deux arguments principaux conduisent à considérer qu’on a ici affaire à la couche la plus ancienne du texte.
- Premièrement, c’est là qu’est employé l’arabe le plus archaïque. Ensuite, dans ces sourates, Muhammad annonce l’imminence de la fin du monde. Comme on sait, elle n’a pas eu lieu. Les musulmans postérieurs n’avaient donc aucun intérêt à fabriquer ces passages qui, en quelque sorte, décrédibilisent leur prophète : ceux-ci doivent donc réellement remonter à Muhammad.
- A l’inverse, certains savants pensent que la majorité des passages qui portent sur le djihad dateraient plutôt des grandes conquêtes, puisqu’ils sont un excellent moyen de légitimer ces dernières. Ils seraient donc postérieurs à Muhammad sans qu’on puisse pourtant déterminer avec certitude leur date.
- Vous avez évoqué la présence de l’histoire d’Abraham ou de celle de Moïse : quelle influence de la Bible peut-on déceler dans le Coran ?
- La présence biblique est gigantesque, même si elle fut longtemps minimisée. La tradition musulmane a fait de l’Arabie préislamique une terre de l’ignorance où l’on adorait les idoles. Si quelques rares versets font en effet référence au paganisme préislamique, le Coran contient surtout des milliers de références à la Bible. De nombreuses figures bibliques y sont présentes, d’Adam à Jésus, en passant par Noé, David, Salomon et, bien sûr, Abraham et Moïse, qui ont une place fondamentale. Qui plus est, les grands thèmes du Coran sont des thèmes bibliques.
- La majorité des passages qui portent sur le djihad seraient postérieurs à Muhammad
- On peut résumer le credo coranique par trois points. Le monothéisme, c’est-à-dire qu’il n’est qu’un seul dieu. Le prophétisme, c’est-à-dire que Dieu révèle sa Parole aux hommes par l’intermédiaire de quelques individus choisis que sont les prophètes. Enfin, le Jugement dernier, c’est-à-dire que dans l’au-delà, les hommes recevront récompense ou châtiment selon leurs actes. Tout cela est évidemment déjà présent dans la Bible et correspond aux croyances des juifs et des chrétiens. On peut d’ailleurs ajouter que les références bibliques sont parfois convoquées de manière allusive dans le Coran, sans préciser des détails que l’on suppose connus. Cela signifie que les auditeurs en étaient familiers.
- Autre indice : le vocabulaire lui-même. Le Coran est évidemment rédigé en arabe, mais de nombreux termes coraniques sont en réalité issus des langues liturgiques employées par les chrétiens d’Orient – le syriaque – ou par les juifs – l’hébreu. Le mot « Coran » lui-même viendrait de qiriyâna, qui désigne un « livre de prières » en syriaque. Les termes salat, qui désigne la prière quotidienne, ou zakat, qui renvoie à l’aumône, seraient également issus du syriaque, tandis que le hadj – le pèlerinage à La Mecque – proviendrait de l’hébreu.
- Comment l’influence biblique s’est-elle répandue dans l’Arabie de Muhammad ?
- L’Arabie n’est pas une île. A l’époque de Muhammad, elle se situe au milieu de civilisations où le judaïsme, le manichéisme et surtout les différents courants chrétiens sont bien installés. Au Nord se trouvent l’empire byzantin, chrétien, et l’empire iranien, qui compte aussi beaucoup de chrétiens, tandis qu’au Sud se trouve le Yémen, où le judaïsme puis le christianisme se sont implantés. Or les Arabes de l’ouest de la péninsule Arabique – et, selon la tradition, Muhammad lui-même – sont des marchands qui circulent entre ces pays. Les livres, les croyances, les hommes ont pu se répandre ainsi.
- Ajoutons que l’Arabie était traversée par des moines itinérants, propagandistes zélés qui ont pu répandre des croyances et pratiques chrétiennes, tandis que certaines tribus arabes avaient quant à elles embrassé le judaïsme. C’est ainsi que l’Arabie a pu être imprégnée de culture biblique, imprégnation que l’on retrouve dans le Coran.
- Vous avez mentionné la présence de Jésus dans le Coran. Comment y est-il évoqué ?
- Jésus y est une figure très importante. Il y est appelé « Jésus, fils de Marie », mais aussi « le Messie », ou bien « le Verbe de Dieu » ou encore « l’Esprit de Dieu ». En revanche, il n’est jamais désigné comme « le Fils de Dieu ». Cela renvoie à une christologie bien particulière. En effet, de nombreux courants chrétiens de l’époque, comme les nestoriens ou les ariens, refusaient la filiation divine du Christ telle qu’elle fut proclamée aux conciles de Nicée (325) et de Chalcédoine (451).
- La crucifixion de Jésus est également évoquée. Le Coran indique que les juifs ont dit avoir crucifié Jésus, mais il précise immédiatement : « C’est ce qui leur a semblé », ou « cela leur est apparu comme tel ». Pour le Coran, Jésus n’a donc pas été véritablement crucifié : celui qui fut cloué sur la croix était une sorte de sosie, tandis que le véritable Jésus fut enlevé au Ciel. Cela correspond à la doctrine du docétisme – du grec dokein, « paraître » –, un courant du christianisme antique qui postule que la crucifixion fut une illusion.
- Vous avez codirigé « Le Coran des historiens » et « Histoire du Coran », dans lesquels vous proposez une analyse historico-critique du Coran. Comment cette démarche est-elle reçue chez les musulmans ?
- L’historien essaie d’appréhender le Coran de manière froide, objective, pas avec un regard confessant. Le Coran est pour lui un document historique que l’on doit contextualiser et appréhender avec une nécessaire distance critique. Disons simplement que l’historien analyse le Coran comme il analyserait l’Odyssée ou Les Misérables. Cela soulève bien sûr des difficultés dans les milieux religieux.
- L’analyse historique met en question certaines croyances mais pas la foi
- Le dogme orthodoxe est que le Coran est la Parole incréée de Dieu, ce qui signifie que Dieu s’y exprime directement. Dans ces conditions, l’analyser pour découvrir comment il s’est constitué humainement, dans une histoire et une géographie, est inenvisageable.
- Les milieux religieux opposent donc une fin de non-recevoir au travail historico-critique. La mosquée Al-Azhar du Caire, autorité religieuse majeure du sunnisme, a ainsi vertement condamné Le Coran des historiens, l’accusant de malveillance à l’égard de la Parole de Dieu.
- Cela étant dit, la réception est beaucoup plus positive dans les milieux intellectuels du monde musulman, au sein desquels on trouve aussi des croyants. Ces milieux commencent à trouver intéressant d’avoir un regard distancié sur leurs propres traditions, sans doute à cause de tout ce qui se fait au nom de l’islam et dont les musulmans sont les premières victimes. Pour eux, l’approche historique du Coran est une véritable opportunité.
- Le regard de l’historien est-il une menace pour la foi du croyant ?
- Je suis persuadé du contraire. Bien sûr, l’analyse historique met en question certaines croyances mais pas la foi, qui reste un mystère. D’ailleurs, certains penseurs de l’islam classique, comme Al-Ghazali (1058-1111) ou Ibn Arabi (1165-1240), distinguant les deux choses, considéraient que certaines croyances sont nocives pour la foi et que s’en débarrasser consoliderait cette dernière.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment